



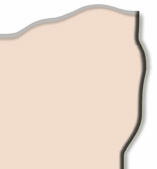

Les Caractères de La Bruyere
VI. Etude d'un extrait : De la cour, remarque 74
a) L'extrait
" L'on parle d'une région où les
vieillards sont galants, polis et civils ; les
jeunes gens au contraire, durs, féroces, sans mœurs ni
politesse : ils se trouvent affranchis de la
passion des femmes dans un âge où l'on commence ailleurs à
la sentir ; ils préfèrent des
repas, des viandes, et des amours ridicules. Celui-là chez eux est
sobre et modéré, qui ne s'enivre que de vin : l'usage trop
fréquent qu'ils en ont fait le leur a rendu insipide ;
ils cherchent à réveiller leur
goût déjà éteint par des eaux-de-vie,
et par toutes les liqueurs les plus violentes ; il ne manque
à leur débauche que de boire de l'eau-forte. Les
femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté
par des artifices qu'elles croient servir à
les rendre belles : leur coutume est de peindre
leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules,
qu'elles étalent avec leur gorge, leurs
bras et leurs oreilles, comme si elles craignaient de cacher l'endroit par
où elles pourraient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux
qui habitent cette contrée ont une physionomie qui n'est pas nette,
mais confuse, embarrassée dans une épaisseur
de cheveux étrangers, qu'ils préfèrent
aux naturels et dont il font un long tissu pour couvrir leur tête
: il descend à la moitié du corps, change les traits, et empêche
qu'on ne connaisse les hommes à leur visage. Ces
peuples d'ailleurs ont leur Dieu et leur roi : les grands de la nation
s'assemblent tous les jours, à une certaine heure, dans un temple
qu'ils nomment église ; il y a au fond de ce temple un autel consacré
à leur Dieu, où un prêtre célèbre des
mystères qu'ils appellent saints, sacrés et redoutables ;
les grands forment un vaste cercle au pied de cet autel, et paraissent debout,
le dos tourné directement au prêtre et aux saints mystères,
et les faces élevées vers le roi, que
l'on voit à genoux sur une tribune, et à qui ils semblent
avoir tout l'esprit et le tout le cœur appliqués. On ne laisse
pas de voir dans cet usage une espèce de subordination ; car ce peuple
paraît adorer le prince, et le prince
adorer Dieu. Les gens du pays le nomment *** ; il est à quelque quarante-huit
degrés d'élévation du pôle, et à plus
d'onze cents lieues de mer des Iroquois et des Hurons.
"
b) Introduction
Le chapitre " De la cour " est composé
de différentes formes littéraires (portraits, réflexions
morales, proverbes, sentences…). Cette remarque diffère du genre
habituel du portrait car il s'agit de la description
d'un ensemble de personnages.
Il y a deux mouvements : la 1ère partie,
qui présente les gens de la cour, la
2nd qui montre un moment particulier dans la vie de la cour, la cérémonie
religieuse.
c) La description des vices de la cour
L'énonciation est très originale car La Bruyère use
d'un personnage fictif qui n'appartient pas au pays dont on fait la description,
la France. Le narrateur semblerait appartenir à une tribu indienne
; La Bruyère se cache derrière son personnage
fictif pour échapper à une attaque. Le style adopté
par le personnage (périphrase pour le mot étranger) est assez
évolué ; il est distant avec les gens (" ils ",
" ceux "…).
Il y a trois aspects différents
:
- La vie des jeunes de la cour, avec une idée
importante de contraire aux qualités des vieux ; ils sont contraires
à la morale et à la nature. On parle de " gens dont le
goût est éteint " ; si l'on considère le goût
comme le jugement, alors ils se trouvent à l'opposé du bon
sens. Les termes violents (débauche…) montrent une jeunesse
moralement corrompue. La fin est sur une hyperbole de " boire de l'eau-forte
", car ce liquide est un acide employé dans les gravures.
- Les femmes de la Cour. Il y a encore l'idée
de contre-nature ; cette idée est un héritage de la philosophie
antique qui exprimait la nature comme un modèle. Les femmes
sont superficielles (artifices, parures, maquillages…). On a une idée
forte avec " peindre " et " étalent " : le goût
de l'artifice qui enlève la beauté naturel montre leur absence
de pudeur ; ce manque est contre la nature et le bon sens.
- Physionomie des personnages. Le vocabulaire
est encore celui de la nature (" qu'ils préfèrent aux
naturels "…). Ce " confus " est
contraire à l'idée de clarté du classicisme
; l'être humain n'est même plus reconnaissable à son
visage : il y a un sentiment d'ironie et d'amertume
de l'auteur. Les hommes de la cour, habillés et ornés,
ne sont ni hommes par l'apparence, ni par leur comportement ; ils sont déshumanisés
et désordonnés.
d) Un moment particulier de la vie de la cour : la
messe
Les gens qui vivent dans la débauche et l'excès vont, dans
la même journée, assister à une cérémonie
sainte et religieuse ; il y a de l'ironie sur cette
apparence de piété. Le cérémonial a un
aspect théâtral avec la position symbolique
du roi, regardé par tous. Le roi avait pouvoir d'essence divine
; l'observateur qui écrit la remarque est choqué. Le passage
est écrit au pluriel, on traite un ensemble alors qu'avant, on avait
des individus.
e) Conclusion
La Bruyère se montre un précurseur de
la critique sociale du 18ème siècle, avec Montesquieu et ses
Lettres Persanes ou Voltaire avec L'Ingénu ;
dans ce dernier livre, le personnage fictif est aussi un Huron (indien).
Cependant, La Bruyère ne remet pas en cause
le régime politique en lui-même : il n'est pas un révolutionnaire
; il remet plutôt en cause le système de fonctionnement. Comme
beaucoup d'auteurs classiques, il reste attaché à la monarchie
et à la religion chrétienne, sur laquelle il fonde sa pensée.